Tout va bien
L'existence du Bitcoin (BTC, ฿) a été révélée au grand public par la faillite de Mt.Gox, l'un des principaux exchanges permettant d'échanger des Bitcoins contre des dollars US et inversement. Le taux ayant baissé à $450 au lieu du record de $1000 en novembre dernier, d'aucuns ont annoncé la fin de cette monnaie en oubliant un peu vite qu'elle ne valait que quelques dollars naguère.
Il ne s'agit bien sûr que d'une péripétie où une sorte de banque met la clef sous la porte, pas d'un Armageddon généralisé pour le monde des cryptodevises. Celles-ci ont de très bonnes raisons de perdurer car elles jouent pour l'Internet le rôle d'un moyen de paiement en voie de disparition, l'argent liquide.
Bitcoin procède d'une idéologie libertarianiste qui vise à ôter le plus possible de pouvoir économique aux états en faisant frapper monnaie par des réseaux P2P sur lesquels n'importe qui peut miner avec son propre ordinateur, et à rendre l'argent à nouveau anonyme pour limiter les possibilités de contrôle de son utilisation. Son caractère spéculatif colle bien à cette idéologie où la prise de risque financier mérite une récompense sans limite. Toujours dans le but de favoriser la spéculation, le Bitcoin est déflationniste, le nombre d'unités étant volontaimement limité à 21 millions ; ce chiffre sera atteint vers 2140.
Tout va mal
C'est là que les choses se compliquent. J'ai parlé de cryptodevises, au pluriel. Les clones de Bitcoin se multiplient. Certains se veulent de réels concurrents comme Litecoin (LTC) ou Primecoin (XPC). D'autres sont de simples gags, comme Fellatio (BLO), dont l'un d'eux, Dogecoin (DOGE), a accédé par surprise au rang de monnaie cotée. Sur 600 créées, il en existe aujourd'hui 400 en activité dont une quinzaine peuvent être échangées contre des BTC à des taux variant entre 0,02 et 0,001. L'antériorité de Bitcoin lui apporte la reconnaissance médiatique, d'où sa valorisation. Cela ne durera qu'un temps.
Le code, l'implémentation des algorithmes faisant fonctionner ces monnaies virtuelles, est presque toujours dérivé de celui de Bitcoin, qui est naturellement open source. Naturellement parce qu'en matière de cryptographie, le code doit pouvoir être revu et contrôlé afin de valider son fonctionnement. Pour un clone, il vaut mieux partir d'une base solide et n'en changer que le strict minimum afin d'éviter tout risque de baisse du niveau de la sécurité et donc de la confiance.
On voit que les cryptodevises qui ne font pas trop n'importe quoi à ce niveau sont équivalentes dans l'absolu. Parmi celles-ci, certaines vont se dégager du lot, surtout pour des raisons marketing, ou peut-être parce qu'une valeur ajoutée (un peu plus sexy que de trouver des sextuplets de nombres premiers) y sera associée. En conséquence, le nombre d'équivalents-BTC se multipliera, le principe déflationniste volera en éclats et les cryptodevises s'effondreront.
Et après ?
Nombreux seront ceux qui trouveront cela dommage. Ceux pour qui le Bitcoin représente une victoire dans leur combat idéologique. Ceux qui auront stocké des Bitcoins. Ceux qui montent actuellement des datacenters bourrés d'ASIC dédiés au mining en Islande ou en Suède. Ceux qui transfèrent internationalement de l'argent à peu de frais. Ceux qui ont besoin d'acheter ou de vendre discrètement de la drogue ou des armes et, en général, tous ceux pour qui le principe du cash virtuel est réellement pratique, tellement qu'il ne peut pas totalement disparaître.
Les monnaies traditionnelles sont toujours garanties par un ou des états qui en contrôlent le volume émis et qui s'engagent à les racheter au besoin. C'est une des bases de la confiance qui établit leur valeur faciale et qui permet au public de les utiliser au jour le jour.
A contrario, c'est le code implémentant les algorithmes et gérant la communication qui garantit la valeur faciale des monnaies cryptographiques, mais on vient de voir que cette seule garantie n'était pas suffisante. Il faut un facteur extérieur équivalent à l'autorité des états. Or ceux-ci ne sont pas prêts à lancer leurs propres monnaies virtuelles, comme le montre le récent communiqué de la Banque de France, alors que d'autres acteurs se préparent sûrement à se placer dans les starting-blocks.
Google, eBay, Facebook, Yahoo... Le poids économique de ces entités commerciales dépasse de loin celui de nombreux pays fondés à battre monnaie. Pourquoi hésiteraient-elles à conforter leur pouvoir ? Le moment venu, elles s'appuieront sur leur puissance financière pour garantir chacune leur propre moyen de paiement. Celui-ci serait toujours virtuel, toujours fondé sur des algorithmes cryptographiques, et il pourrait même rester décentralisé et P2P. La compagnie lui fournirait un petit quelque chose en plus, peut-être inhérent au code mais pas forcément, comportant en tout cas un éventail d'actions destinées à inspirer confiance comme l'achat massif de devises afin de soutenir le cours : rien que de très classique dans ce domaine.
Cet accaparement de la monnaie par des sociétés commerciales représentera la dernière étape du processus actuel de discrédit des états, qui crée un vide où s'engouffrent les acteurs privés. Le libertarianisme nourri des préceptes d'Ayn Rand vise à détruire l'État, vu comme le mal absolu, au profit de l'individu ; mais en fait seuls quelques-uns des individus en profiteront réellement et les vraies gagnantes seront les corporations.
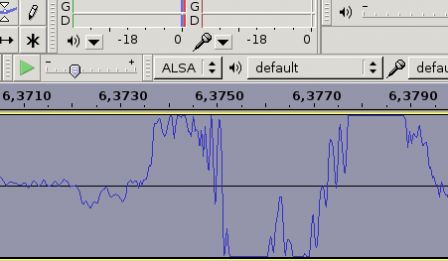
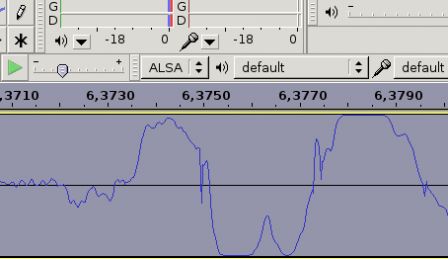
















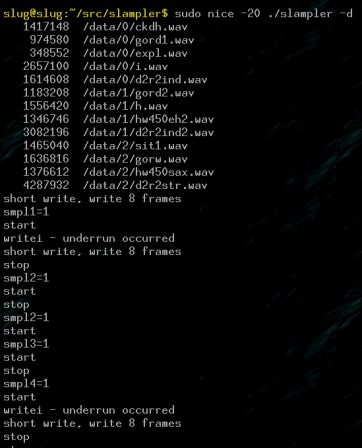






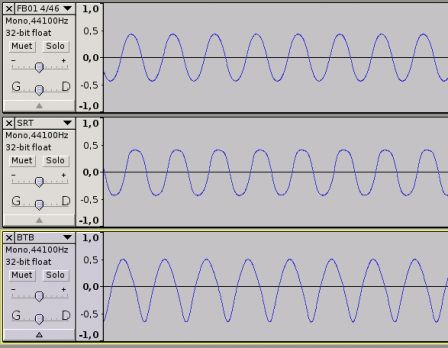
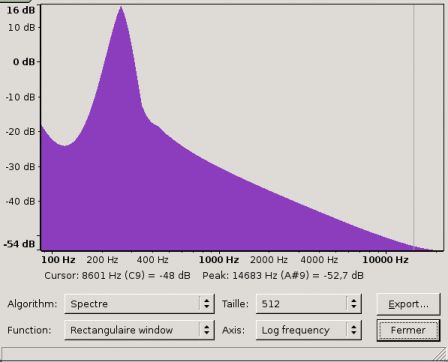
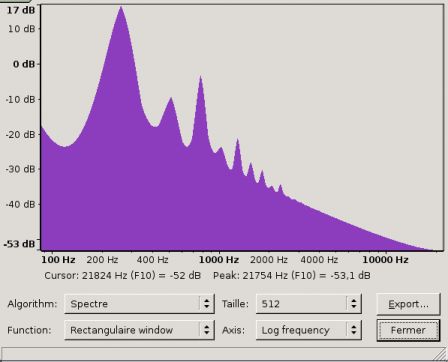
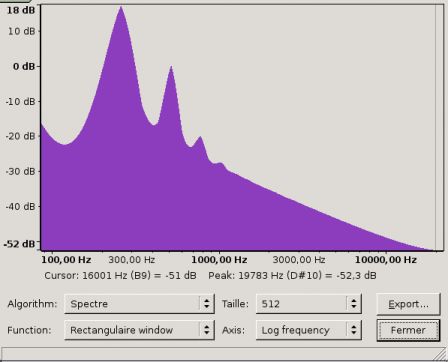
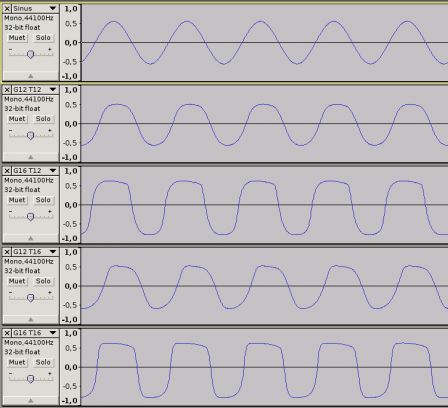
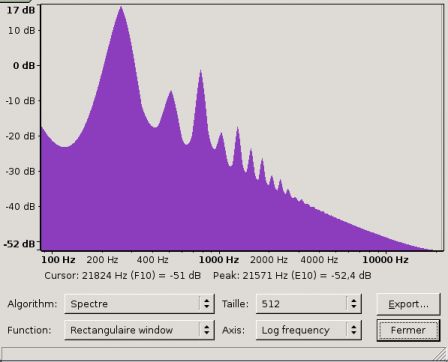
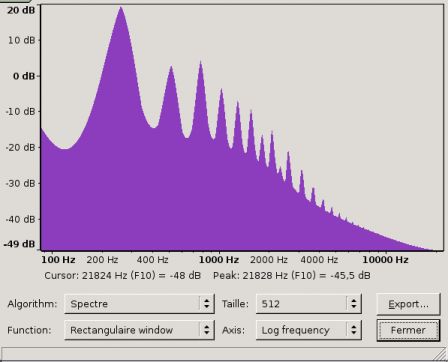
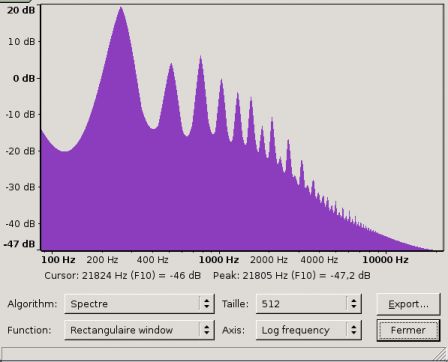
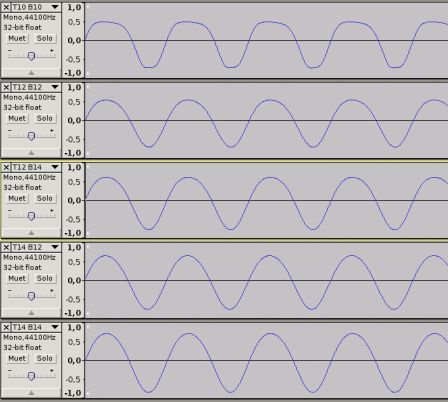
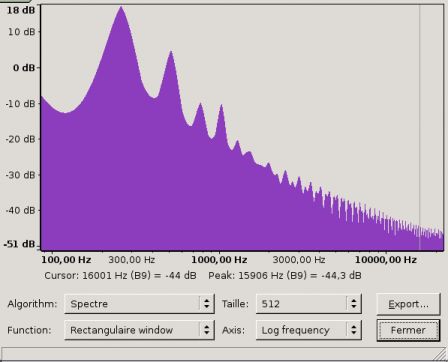
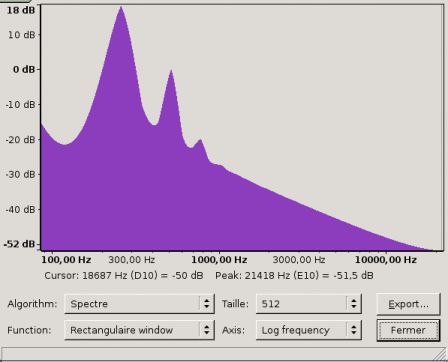
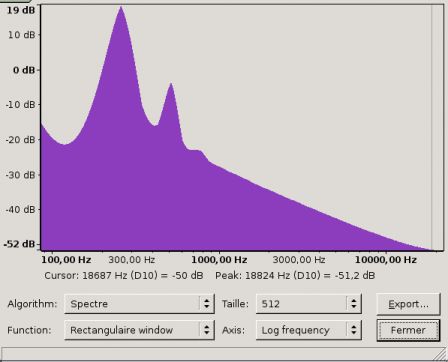
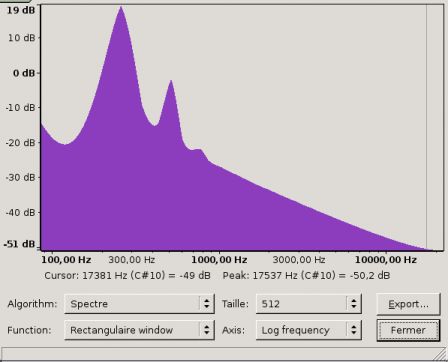



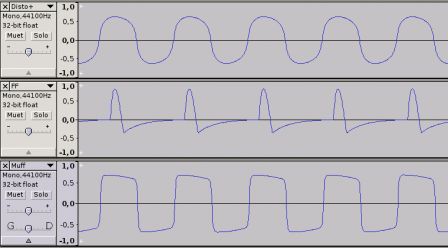
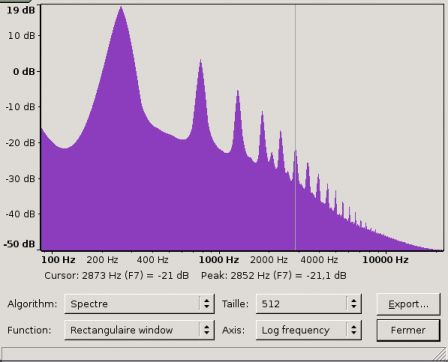
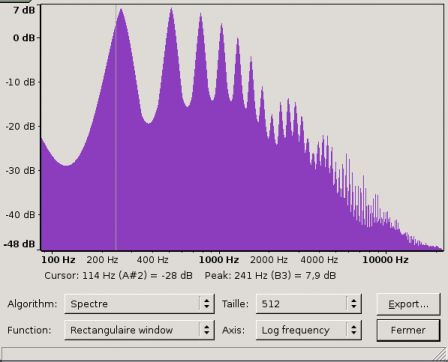
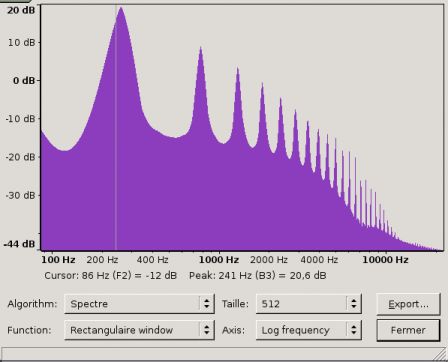

Derniers commentaires